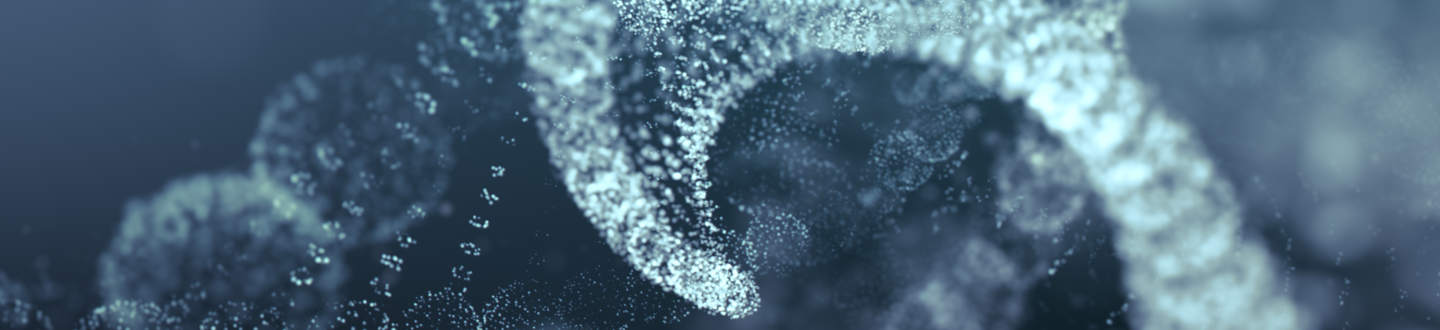Cette maladie touche entre 400 et 600 nouveaux patients par an en France. Les tumeurs neuroendocrines de l’intestin grêle sont particulières car un même patient peut avoir de multiples tumeurs de ce même type de cancer (jusqu’à 100), localisées sur le tube digestif. Ce ne sont pas des métastases, mais différentes tumeurs primaires qui, bien que toutes petites, sont nombreuses.
Si le taux de survie des patients atteints par ce type de cancer est plutôt bon, l’évolution de la maladie est lente et donc difficile à diagnostiquer. Elle sécrète des hormones toxiques à très haut niveau qui peuvent notamment abîmer le cœur et engendrer des problèmes cardiaques.
L’équipe cherche à comprendre les mécanismes de cette invasion et à guérir ces tumeurs, autour de deux axes principaux de recherche.
COMPRENDRE LES SPECIFICITES DE LA MALADIE
Le premier axe de recherche, très fondamental, vise à comprendre l’origine des tumeurs neuroendocrines de l’intestin grêle et notamment pourquoi certains patients peuvent développer des centaines de tumeurs indépendantes. Pour cela, les chercheurs observent les cellules dites « entéroendocrines » présentes dans l’intestin grêle.
Dans des conditions normales, les cellules entéroendocrines détectent le contenu de l'intestin et libèrent des hormones pour réguler l'activité gastro-intestinale, l’alimentation et l’ensemble des réactions chimiques qui se déroulent dans l'organisme.
De nombreux sous-types de cellules entéroendocrines ont déjà été étudiés mais peu de connaissances existent sur le comportement de ces cellules au moment de la formation des tumeurs neuroendocrines de l'intestin grêle.
Pour les observer, les chercheurs effectuent sur de nombreux échantillons des analyses poussées de l’expression des gènes et de leurs mutations. L’objectif final de l’équipe est de comprendre la formation de ces tumeurs neuroendocrines pour pouvoir développer de nouvelles thérapies associées.
Dr Benjamin Gibert, directeur de l’équipe « Gastroentérologie et technologies pour la santé »
« Pour notre équipe, les dons sont un réel coup de pouce. Ils nous permettent par exemple, lorsque nous en avons besoin, de financer un nouveau poste de doctorant ou de chercheur et d’accélérer ainsi nos recherches. Nous sommes très heureux d’être basés au Centre Léon Bérard, tant pour le soutien financier qu’humain. »
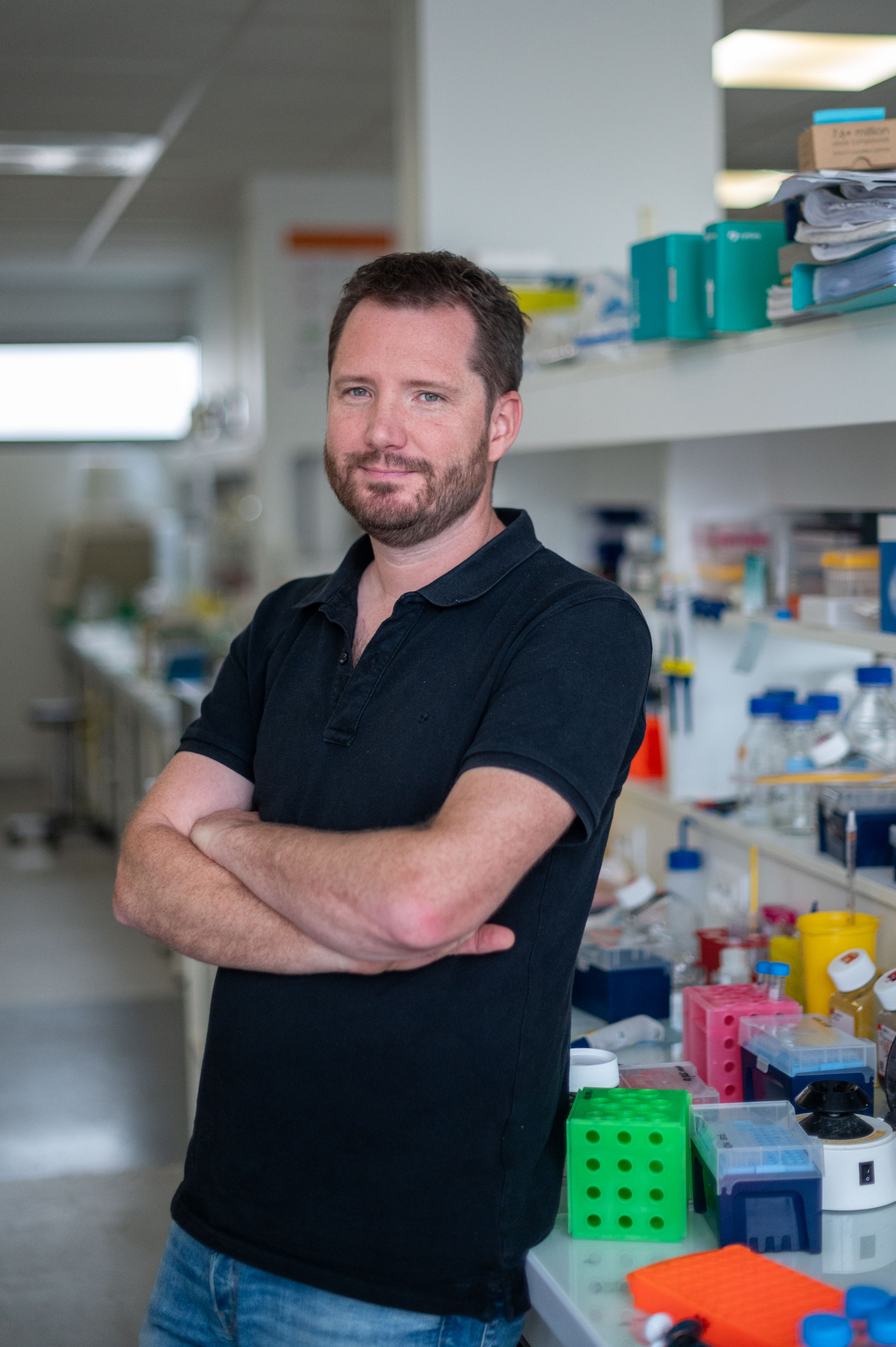
TROUVER LES TRAITEMENTS INNOVANTS DE DEMAIN
Le second axe vise donc à développer de nouvelles molécules anticancéreuses innovantes qui seront ensuite transformées en médicaments, plus puissants que ceux utilisés à ce jour.
Lorsque nous sommes contaminés par une infection virale ou une bactérie, notre corps secrète des anticorps pour la détruire. De nombreuses équipes de recherche essaient de reproduire ce processus en créant des anticorps spécifiques pour lutter contre une tumeur, le but étant que le système immunitaire reconnaisse ces anticorps sur la tumeur et la détruise. Mais cela ne fonctionne pas toujours.
Pour pallier ces problèmes, l’équipe « Gastroentérologie et technologies pour la santé » utilise une technologie prometteuse appelée radiothérapie interne vectorisée, déjà utilisée par les oncologues pour traiter les tumeurs neuroendocriniennes. Deux médicaments utilisant ce procédé sont d’ailleurs fabriqués sur le site du Centre Léon Bérard.
Pour aller encore plus loin, elle a identifié des protéines à la surface des cellules cancéreuses des tumeurs neuroendocrines qui seraient une excellente cible pour une radiothérapie interne vectorisée. Les chercheurs ont ensuite développé un système pour coupler les radioéléments (atomes métalliques qui émettent des particules radioactives) aux anticorps.
Concrètement, le but est de venir injecter de la radioactivité sur les protéines de surface des cellules cancéreuses. Les anticorps vont alors s’accumuler dans la tumeur, ce qui va attirer le radioélément et ainsi détruire la tumeur.
Pour cela, elle collabore avec l’entreprise française Orano qui fournit les métaux radioactifs et l’expertise pour leur utilisation.
Copyright photos : Romain Etienne, Romane Tourral